Paris Sciences & Lettres a participé au concours 2016 « Ma thèse en 180 secondes » (MT180), organisé par le CNRS et la CPU.
La doctorante appelée à défendre les couleurs de PSL au niveau national le 31 mai 2016 à Bordeaux a été sélectionnée lors de la Finale PSL, le mercredi 13 avril.
Le jury était composé de :
- Henri Berestycki – Doyen de la Recherche PSL (Président du jury MT180s)
- Claire Baritaud – Docteur Mines ParisTech, ingénieur élève du Corps des Mines
- Isabelle Catto – Doyenne de la Formation PSL
- Nelly Manoukian – Directrice de la Communication PSL
- Matteo Merzagora – Directeur de l’Espace des Sciences Pierre Gilles de Gennes
Les candidats
 Pauline Bégué
Pauline BéguéEcole normale supérieure
 Guillaume Carton
Guillaume CartonUniversité Paris-Dauphine
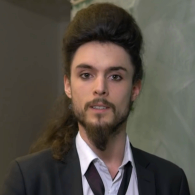 Thomas Ferrand
Thomas FerrandEcole normale supérieure
 Thomas Le Gallic
Thomas Le GallicMINES ParisTech
 Laura Le Du
Laura Le DuMINES ParisTech
 Iryna Lystopad
Iryna LystopadEPHE
 Auderic Maret
Auderic MaretEHESS
 Alice Moussy
Alice MoussyEPHE
 Quentin Perrier
Quentin PerrierEHESS
 Camille Pluntz
Camille PluntzUniversité Paris-Dauphine
 Benjamin Scholtes
Benjamin ScholtesMINES ParisTech
Cliquez sur une photo pour découvrir une courte présentation du candidat
La finale PSL
Cliquez sur le nom d’un(e) candidat(e) pour accèder directement à son pitch.
- Auderic Maret (EHESS) Défendre la ville : Marseille, le roi de France et la Méditerranée de 1481 à 1559.
- Pauline Bégué (Ecole normale supérieure) « Médecin-malade », paradoxe ou paradigme ? Du contre-sens, de l’épochè à l’utopie.
- Camille Pluntz (Université Paris-Dauphine) L’extension incongruente, un risque pour les légitimités de la marque humaine? Application aux réalisateurs de film.
- Thomas Le Gallic (MINES ParisTech) Exploration des évolutions des modes de vie dans les exercices de prospective énergie-climat : développement méthodologique en vue d’appréhender la réalité socioéconomique d’hypothèses de rupture.
- Alice Moussy (EPHE) Caractérisation des premières étapes de différenciation des cellules souches hématopoïétiques à l’échelle de la cellule unique.
- Benjamin Scholtes (Mines ParisTech) Développement d’un formalisme level set performant pour la modélisation en champ complet de la recristallisation dans un contexte industriel.
- Thomas Ferrand (Ecole normale supérieure) Reproduction expérimentale d’analogues de séismes mantelliques et comparaison avec des pseudotachylites naturelles.
- Guillaume Carton (Université Paris-Dauphine) La production des connaissances managériales : du rapport de la recherche à la pratique.
- Alice de Rochechouart (EPHE) L’eschatologie du présent, un motif dans la philosophie contemporaine française.
- Quentin Perrier (EHESS) Analyse des impacts micro- et macro-économique des énergies renouvelables dans le secteur électrique en Europe.
- Laura Le Du (MINES ParsiTech) Les dispositifs collaboratifs permettant de stimuler les imaginaires sociotechniques dans les écosystème industriels.
- Iryna Lystopad (EPHE) L’aspect logique de la métaphysique trinitaire au milieu du XIIème siècle.
Les participants à la finale PSL de « Ma Thèse en 180 secondes », le 13 avril 2016, vous font partager leur expérience avec enthousiasme.
Alice de Rochechouart a remporté la finale Paris Sciences & Lettres (PSL) du concours.

La finale nationale
La demi-finale nationale du concours a eu lieu à huis clos le 30 mai 2016 à Bordeaux. Lors de cette demi-finale, les 28 doctorants lauréats de chaque ComUE ont de nouveau exposé leur sujet de thèse, mais chaque doctorant devait également juger la prestation des autres candidats en fonction d’une grille pré-établie.
Au terme de cette demi-finale, 16 candidats sur les 28 ont été sélectionnés pour participer à la finale. Notre finaliste PSL, Alice de Rochechouart, a brillamment réussi cette étape.
La finale nationale s’est déroulée le lendemain, le 31 mai 2016, au Palais de la Bourse de Bordeaux devant un large public.
- 1er prix : Mathieu Buonafine, Sorbonne Universités, « Etude du rôle de la Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin dans les effets cardiovasculaires de l’activation du récepteur minéralocorticoïde »
- 2eme prix et prix du public : Bertrand Cochard, Université Côte d’Azur, « Réification, spectacle et imagification dans la philosophie de Guy Debord »
- 3eme prix : Nicolas Urruty, Université confédérale Léonard de Vinci, « Etude de l’impact de la réduction des pesticides sur le rendement du blé en France »
MT180 2016 - Quentin Perrier (EHESS)
Analyse des impacts micro- et macro-économique des énergies renouvelables dans le secteur électrique en Europe
MT180 2016 - Pauline Bégué (Ecole normale supérieure)
« Médecin-malade », paradoxe ou paradigme ? Du contre-sens, de l’épochè à l’utopie
École normale supérieure – ED 540 – École doctorale transdisciplinaire Lettres/Sciences, thèse dirigé par Frédéric Worms et Cynthia Fleury.
Pauline s’est intéressée au monde du soin et de l’hospitalier suite à ses expériences professionnelles en tant qu’étudiante sage-femme. Elle souhaitait se saisir de son propre vécu en l’envisageant dans une réflexion sociologique et philosophique du champ médical. Dans sa thèse, elle mène une réflexion sur la relation entre les médecins et leurs patients à travers la figure du “médecin-malade” qui permet de faire interagir deux univers symboliques en apparente contradiction. Par ce renversement de position, que pourraient nous apprendre ces “médecins-malades” sur ce qu’il y a de fondamental dans la relation de soin?
“Médecin–malade”. Cette expression renvoie spontanément chacun à la relation entre un médecin et un malade, et suppose une réflexion autour de leur relation. Médecin et malade se définissent réciproquement dans leur rapport à l’autre et s’individualisent différemment de chaque côté du trait d’union. Il semble ainsi qu’envisager un médecin vivant l’épreuve d’une maladie, un médecin-malade pourtant, relève de l’ oxymore, du paradoxe. La figure du médecin-malade, en apparence singulière, réunit en sa personne, deux mondes, un hiatus, une “rupture épistémologique”: entre le vécu et le conçu, l’éprouvé et le pensé, l’affect et le concept. Leur rencontre en lui est l’occasion de “croiser deux discours” et de mettre en tension leur différend. En prêtant attention à ce qui émerge de cette contraction, le médecin-malade pourrait-il nous aider à penser, dans un discours commun, l’union de deux énoncés, deux cosmovisions que tout semble séparer?
Chez le médecin-malade, les maux se révèlent par l’expérience. Le chiasme – médecin-malade – sous-tend une conflictualité que rencontre, de fait, le médecin-malade. Il (s’) observe des deux côtés en vivant l’expérience d’une interchangeabilité des places institutionnelles, d’un brouillage des positions, d’une complexification du soi. Par ce renversement des rôles, cette multiplicité des regards, le médecin-malade devient un entre-deux productif qui n’est pas seulement l’entre-les-deux-cotés mais un passage, conduisant à une tierce vision sur l’institution médicale.
Le médecin-malade, qui vit non seulement une expérience de vie intime mais aussi une double relation (patient avec ses soignants, mais aussi médecin avec ses patients), laisse entrevoir une réflexion éthique.
Mais si nous portons aussi au médecin-malade un intérêt anthropologique et politique, c’est par le renversement qu’il produit, non seulement de par son inversion (de sens, statut, position) mais aussi par la “conversion politique” qu’il engendre. Tout se passe comme si le médecin-malade s’emparait de cet espace conflictuel, de ce trait d’union pour créer un mouvement, un agir autre, un agir avec l’autre.
Ce moment du “médecin-malade” permet de dévoiler l’ici et maintenant de la relation de soin et plus généralement des relations particulières entre les hommes. Cette relation de soin, qui est à la fois relation professionnelle et pédagogique, institutionnelle et sociale, éthique et politique se loge à la frontière entre relation intime et publique. Médecin-malade permet de penser la relation soignant-soigné mais plus largement la relation d’enseignement et de soin, en tant qu’elle est une relation éthique – de responsabilité et de réciprocité – mais aussi proprement politique, en ce que ce médecin-malade laisse émerger de par sa “voix différente” un ensemble de conflits et de contradictions, et stimule ainsi un agir – entre création et transmission.
MT180 2016 - Guillaume Carton (Université Paris-Dauphine)
La production des connaissances managériales : du rapport de la recherche à la pratique
Soutenue le 10 décembre 2015, sous la direction de Stéphanie Dameron (Université Paris-Dauphine)
 Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?
Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?
Né d’un qu’un questionnement sur la différence entre conseil en management et recherche en sciences de gestion qui m’a mené à effectuer mon mémoire de master 2 sur ce thème. La thèse élargit la thématique en cherchant à comprendre comment la connaissance managériale et produite par interaction entre chercheurs et praticiens.
Avec qui avez-vous travaillé sur vos recherches ?
J’ai travaillé avec Stéphanie Dameron, ma directrice de thèse (Université Paris-Dauphine), mais également avec Philippe Mouricou, actuellement associate professor à l’ESSCA avec qui nous avons rédigé un chapitre de ma thèse. J’ai également eu l’occasion d’interviewer de nombreux chercheurs issus d’institutions du monde entier ainsi que de nombreux consultants et managers et plus généralement de rencontrer de nombreux collègues de par le monde qui m’ont beaucoup apportés.
Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (l’impact socio / économique / scientifique) visible et tangible pour le grand public ?
Pour le moment, la thèse a été présentée à 2 cabinets de conseil en management afin de leur montrer comment ce métier peut bénéficier de l’apport de la recherche en sciences de gestion. Les articles issus de la thèse sont actuellement en processus de publication, donc l’impact scientifique n’est pas encore avéré.
Qu’est-ce que PSL vous a apporté concrètement dans le cadre de vos études ? (collaborations, diffusions, informations, etc).
De façon concrète, l’apport immédiat de l’intégration de l’université Paris-Dauphine au sein de PSL est un accès facilité aux bases de données de recherche, aux prêts facilités entre universités membres de PSL. On sent également un rapprochement avec des laboratoires de recherche membres de PSL aux thématiques proches (laboratoires de gestion de l’école des Mines notamment).
MT180 2016 - Alice de Rochechouart (EPHE)
L’eschatologie du présent, un motif dans la philosophie contemporaine française
Sous la direction de Vincent Delecroix (EPHE)
 Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?
Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?
Je travaille sur une notion originellement religieuse, l’eschatologie, qui désigne la conception de la fin du monde et de la vie après la mort. Mon travail consiste à étudier l’eschatologie en philosophie, c’est-à-dire se demander comment les grands philosophes, de Kant à Derrida, se posent les questions de la fin du monde, du but de l’humanité et de la destinée de chacun. Je souhaiterais montrer qu’il y a un renversement dans cette conception depuis la seconde moitié du XXème siècle, avec un recentrage sur le présent quand le futur paraît de plus en plus incertain. C’est une question qui m’a toujours semblé non pas seulement importante, mais vitale ! Quand j’ai donc décidé de faire une thèse en philosophie, c’est le sujet qui s’imposait.
Avec qui avez-vous travaillé sur vos recherches ? Quelle grande figure (de la science / lettres / sciences humaines) vous a inspirée ?
Je n’ai pas fait d’études de philosophie au départ, et lorsque j’ai commencé, il y a quatre ans, j’ai eu la chance de rencontrer Vincent Delecroix (EPHE), qui est devenu mon directeur de master puis mon directeur de thèse. C’est donc lui qui m’a intégralement formée à la philosophie : je suis 100% Delecroix ! J’ai pu rencontrer et suivre les séminaires de nombreux autres philosophes, mais c’est lui qui guide le plus mes recherches.
Quant aux grandes figures qui m’ont inspirée, je dois dire que je suis une grande adepte de Kant. (Je ne devrais pas le dire, mais il figure d’ailleurs en fond d’écran de mon téléphone…) Mais c’est Albert Camus, avec son questionnement sur l’absurde, qui le premier m’a fait comprendre que je désirais consacrer ma vie au monde des idées.
Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (l’impact socio / économique / scientifique) visible et tangible pour le grand public ?
Comme je l’ai déjà dit, la philosophie est pour moi quelque chose de vital, d’essentiel. C’est pour cela que je m’intéresse tout particulièrement à la philosophie pratique, et à cette question du but individuel et collectif de l’humanité. Le message que je voudrais transmettre, c’est que tout le monde a besoin de la philosophie, dans sa vie quotidienne ! Sans faire de la philosophie de comptoir, mais en allant chercher chez les grands philosophes des questionnements et des réflexions indispensables à la vie. Pour mieux vivre, mieux réfléchir, et mieux agir. Si ce message peut toucher au moins quelques personnes, j’aurai déjà le sentiment d’avoir eu une répercussion sur le grand public !
Qu’est-ce que PSL vous a apporté concrètement dans le cadre de vos études ? (collaborations, diffusions, informations, etc).
L’intégration de l’EPHE au sein de PSL est très récente, donc je n’ai pas pu encore expérimenter les forces de l’environnement PSL. Néanmoins, je suis très contente de faire partie d’un ensemble d’établissements aussi divers : c’est grâce à cette diversité que nous avons passé un aussi bon moment lors du concours Ma Thèse en 180 secondes le 13 avril. C’était une chance de pouvoir rencontrer tous ces doctorants d’horizons si différents !
MT180 2016 - Thomas Le Gallic (MINES ParisTech)
Exploration des évolutions des modes de vie dans les exercices de prospective énergie-climat : développement méthodologique en vue d’appréhender la réalité socioéconomique d’hypothèses de rupture
Sous la direction de Nadia MAIZI (Professeur et Directrice du CMA, Mines ParisTech)
 Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?
Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?
Après un voyage de 6 mois à travers l’Europe pour découvrir les initiatives prises pour lutter contre le changement climatique, j’ai travaillé comme consultant pendant 4 ans sur ces enjeux dans une société appelée ACTeon. J’ai pu constater au contact des collectivités territoriales, de l’ADEME ou du Ministre de l’écologie que face aux enjeux énergétiques et du changement climatique, la question des modes de vie était souvent évoquée mais rarement abordée de front, car c’est une notion complexe et qui recouvre de nombreux aspects de nos sociétés. J’ai souhaité contribuer à combler ce manque en initiant ce sujet.
Quelle grande figure (de la science / lettres / sciences humaines) vous a inspirée ?
Ils m’ont inspiré plus ou moins directement : André Gorz (philosophe), Gaston Berger (prospective), Edgar Morin (complexité)… et bien d’autres.
Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (l’impact socio / économique / scientifique) visible et tangible pour le grand public ?
Il est attendu que mon travail facilite la mise en débat de la question de nos futurs modes de vie et contribue ainsi à lutter contre le changement climatique. S’interroger sur notre futur est une manière d’orienter nos choix et ceux des décideurs politiques. C’est aussi considérer que nous sommes tous les artisans de notre futur et non pas les victimes d’un avenir imposé.
MT180 2016 - Laura Le Du (MINES ParisTech)
Les dispositifs collaboratifs permettant de stimuler les imaginaires sociotechniques dans les écosystème industriels
Sous la direction de Pascal Le Masson, (Professeur à Mines ParisTech)
 Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?
Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?
« Les imaginaires : une ressource, au service de l’innovation. »
Nos outils pour anticiper les tendances sont aujourd’hui à bout de souffle, car les représentations qui servaient jusqu’à présent à l’élaboration des tendances stables, durables et unidirectionnelles s’expriment aujourd’hui de manière multiple et parfois même contradictoire. Dans le désordre des informations qui servaient avant de boussole, il est donc nécessaire de changer d’attitude vis-à-vis de cette notion que sont les imaginaires pour les voir, non plus comme une contrainte pour la conception de nos produits, mais plutôt comme une ressource d’innovation.
En alliant les compétences industrielles et académiques, nous rêvions d’élucider « Comment les imaginaires peuvent être une ressource activable les innovateurs ? ».
Avec qui avez-vous travaillé sur vos recherches ? Quelle grande figure (de la science / lettres / sciences humaines) vous a inspirée ?
Par « grandes figures », nous comprenons les auteurs d’une autre époque qui ont marqué leur temps. Et les contemporains apportent aussi beaucoup. J’ai la chance de travailler en collaboration avec ceux qui sur le terrain industriel développent des initiatives originales en innovation, comme Dominique Levent et Lomig Unger. Et ceux qui, côté académique, modélisent scientifiquement des processus pro-actif pour les industriels, comme Pascal Le Masson, Sophie Hooge et Armand Hatchuel.
Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (l’impact socio / économique / scientifique) visible et tangible pour le grand public ?
La thèse offre une lecture scientifique des dispositifs d’innovation originaux menés en entreprise, développés par l’intuition des acteurs industriels. Elle contribue dans l’entreprise, à légitimer ces initiatives atypiques nécessaires pour l’innovation à tous point de vue.
En sciences de gestion, les résultats de la thèse vont permettre d’éclairer de nouveaux modèles d’action de l’innovation. Au niveau managérial, ils vont permettre de décrire en détails les dispositifs, c’est-à-dire les groupes d’individus à mobiliser, les outils et méthodes de pilotage à déployer pour ouvrir les voies d’innovation à l’aide des imaginaires, reproductibles dans tous types d’entreprise et de secteurs.
En philosophie et en psychanalyse, nous contribuerons, à apporter un modèle qui décrit la dynamique des imaginaires, mais également les leviers d’action pour laisser à voir le potentiel de valeur des imaginaires.
Qu’est-ce que PSL vous a apporté concrètement dans le cadre de vos études ? (collaborations, diffusions, informations, etc).
Nous faisons partie aux Mines ParisTech du groupement qui a soutenu le rattachement à PSL. Les partenariats entre les Ecoles de PSL sont une réalité et leurs valeurs s’observent tous les jours.
MT180 2016 - Iryna Lystopad (EPHE)
L’aspect logique de la métaphysique trinitaire au milieu du XIIème siècle
Sous la direction de Dominique Poirel (IRHT)
 Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?
Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?
Mon directeur de thèse Dominique Poirel m’a proposé de travailler sur une œuvre d’Achard de Saint-Victor qui a été peu étudiée jusqu’à présent. De ma côté, j’ai apporté une problématique qui m’intéresse : l’histoire de la logique, le problème de l’identité, la notion du concept.
Avec qui avez-vous travaillé sur vos recherches ?
– Dominique Poirel, IRHT – mon directeur de thèse français
– Andriy Vasylchenko, Académie de Sciences d’Ukraine – mon directeur de thèse ukrainien
– Julie Brumberg-Chaumont, LEM, Paris
– Irene Caiazzo, LEM, Paris
Quelle grande figure (de la science / lettres / sciences humaines) vous a inspirée ?
Aristote, Augustin
Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (l’impact socio / économique / scientifique) visible et tangible pour le grand public ?
Je reconstruis des solutions médiévales des problèmes de l’identité d’un objet, et de la définition d’une unité intelligible. Ces solutions peuvent contribuées au développement de la méthodologie des recherches.
Quelques lignes sur l’environnement PSL : Qu’est-ce que PSL vous a apporté concrètement dans le cadre de vos études ? (collaborations, diffusions, informations, etc).
Je suis le cours d’humanités numériques dont l’enseignement est assuré par des établissements membres du PSL. Je crois que la collaboration interuniversitaire permet de former des groupes pour étudier les sujets plus étroits de manière plus efficace.
MT180 2016 - Auderic Maret (EHESS)
Défendre la ville : Marseille, le roi de France et la Méditerranée de 1481 à 1559
Sous la direction de Jean Boutier (EHESS)
 Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?
Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?
L’idée était de voir comment à la Renaissance un transfert de souveraineté se déroule c’est-à-dire comment s’effectue le passage d’un espace politico-culturel donné, ici en l’occurrence le comté de Provence, Etat souverain et indépendant lié depuis très longtemps à la Méditerranée mais surtout à l’Italie et aux grandes cités-Etats (Gênes, Florence, Venise) à un autre espace politico-culturel différent, le royaume de France, qui malgré quelques points communs, est différent. Je voulais voir comment un tel transfert pouvait se passer, sans être encombré par des schémas idéologiques comme le régionalisme ou le nationalisme qui se développent en même temps que l’apparition des Etats-nations en Europe au XIXe siècle.
L’idée m’est venue en voyant plutôt les échecs ou les tensions qui suivent généralement un tel transfert de souveraineté ou après un changement institutionnel important. Il y a plusieurs exemples depuis le XVe siècle, et il n’y a aucun intérêt à en faire une liste exhaustive. Je vais prendre deux exemples contemporains pour me faire comprendre. Je pense par exemple aux tensions entre Barcelone, à la tête de la Catalogne, qui est dans la même situation où se trouvait Marseille à la tête de la Provence à la fin du Moyen Age, par rapport à son Etat central dirigé depuis Madrid.
Avec qui avez-vous travaillé sur vos recherches ? Quelle grande figure (de la science / lettres / sciences humaines) vous a inspirée ?
En premier lieu j’ai travaillé avec mon directeur de thèse Jean Boutier ainsi que différents directeurs de recherche rencontrés au cours de séminaires à l’EHESS. Cette formation m’a permis de développer ma propre pensée et c’est sans doute ce que j’apprécie le plus à l’EHESS, cette liberté de pensée. Mais je passe une grande partie de mon temps dans des bibliothèques ou des centres d’archives en France ou à l’étranger. Je précise que ce travail ne consiste pas seulement à rester seul dans une pièce avec des manuscrits mais m’amène également à dialoguer avec des conservateurs, des attachés de conservation et des bibliothécaires.
Je n’ai pas de grande figure qui m’aurait inspiré, je dirais que plusieurs personnalités m’ont donné le goût de la recherche en histoire et plus généralement pour les sciences sociales. Je travaille sur des enjeux et des jeux de pouvoirs à différentes échelles à travers le prisme urbain, je dirais que ma démarche ressemble, en plus modeste à celle de Patrick Boucheron, qui vient d’être élu au Collège de France. L’histoire urbaine me permet de toucher et de jongler avec des disciplines aussi diverses que l’histoire, l’archéologie, l’histoire de l’art et la science politique ou encore la sociologie et l’anthropologie. J’ai aussi été influencé durant mes années de classe prépa par les lectures que j’ai pu faire de Daniel Arasse, décédé aujourd’hui et ancien directeur d’études à l’EHESS. Enfin, sur la réflexion politique ou les questions de pouvoir, j’ai beaucoup lu et je suis sans doute influencé par mes lectures de Michel Foucault.
Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (l’impact socio / économique / scientifique) visible et tangible pour le grand public ?
Mon rôle en tant qu’historien n’est pas de donner des recettes pour le présent ou l’avenir, mais de donner du grain à moudre pour les citoyens. Ma thèse permet de montrer que des questions d’histoire politique et d’histoire culturelle des XVe et XVIe siècles sont des questions toujours d’actualité qui portent sur des enjeux de pouvoirs qui nous concernent tous (l’intégration de populations nouvelles dans un Etat, transferts culturels, la souveraineté, l’identité nationale).
Qu’est-ce que PSL vous a apporté concrètement dans le cadre de vos études ? (collaborations, diffusions, informations, etc).
La formation de cette Comue est encore récente, quand j’ai commencé mes études PSL n’existait pas encore. Mais depuis que cela existe c’est l’environnement culturel dont j’ai profité. PSL fédère des initiatives venant de l’ensemble des établissements membres. De plus, PSL communique beaucoup et permet de voir ce que font les autres établissements. L’EHESS est une école où il n’y a que des sciences sociales, PSL permet d’avoir une ouverture sur les sciences dites » dures » développées dans d’autres établissements comme les Mines par exemple. MT 180 est une de ces initiatives qui permet de voir ce que les autres établissements font.
MT180 2016 - Alice Moussy (EPHE)
Caractérisation des premières étapes de différenciation des cellules souches hématopoïétiques à l’échelle de la cellule unique
Sous la direction du Pr Andras Paldi
 Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?
Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?
Les cellules souches du sang sont des cellules capables de donner tous les éléments du sang. Comprendre leur fonctionnement a suscité en moi une curiosité tout particulière pour ces cellules, et pouvoir améliorer grâce à mon approche probabiliste les traitements utilisés pour des patients atteints de maladies du sang est une grande source de motivation.
Avec qui avez-vous travaillé sur vos recherches ?
J’ai travaillé avec le Pr Andras Paldi, le Dr Daniel Stockholm et le Dr Jérémie Cosette.
Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (l’impact socio / économique / scientifique) visible et tangible pour le grand public ?
Je travaille pour le Généthon, le laboratoire du Téléthon. Ma thèse permettra, je l’espère, d’améliorer les protocoles de traitements de thérapie génique pour les maladies génétiques du sang.
MT180 2016 - Camille Pluntz (Université Paris-Dauphine)
L’extension incongruente, un risque pour les légitimités de la marque humaine? Application aux réalisateurs de film
Sous la direction de Bernard Pras (Professeur, Université Paris-Dauphine)
 Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?
Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?
Ma thèse se focalise sur un objet de recherche encore en développement en marketing : la marque humaine. Ce concept amène à aborder les individus détenant des associations identitaires médiatiques et/ou professionnelles fortes, comme des marques (par exemple : David Beckham, Brigitte Bardot, Woody Allen). Ce concept est intéressant car il propose de regarder les parcours de ces individus à travers un nouvel angle, celui de l’identité et de la stratégie de marque.
Dans ma thèse, je me pose la question de certains choix de carrière qui peuvent paraître hasardeux parce que trop éloignés du cœur de métier, et donc de l’identité de marque de l’individu. Que se passerait-il si David Beckham décidait de devenir joueur de rugby ? Cela affecterait-il sa légitimité en tant que joueur de football ? Ou si Woody Allen réalisait un » RoboCop « , un film de science fiction, commercial de surcroît, alors que nous associons systématiquement ses films à des films d’auteur du type plutôt comédie dramatique ?
En travaillant sur les réalisateurs de films en tant que marques, je montre qu’un principe marketing théorique lié à l’extension de marque ainsi qu’à la dilution de l’identité de marque est respecté: lorsqu’un réalisateur s’aventure sur un film différent et inhabituel, et que ce film est un échec, l’identité de marque du réalisateur n’est pas touchée, donc sa légitimité initiale n’est pas atteinte. Il peut repartir refaire les films dont il a plus l’habitude, sans problème, et sans être pénalisé par qui que ce soit (l’industrie cinématographique, les critiques ou le grand public). D’ailleurs, les résultats de ma thèse amènent à recommander aux réalisateurs de faire un film qui sort du cadre, au moins de temps à autre. Mieux vaut rater un film inhabituel et ponctuel qu’un énième film habituel ! Dans ce deuxième cas, les effets sont malheureusement plus négatifs pour le réalisateur.
Passionnée de cinéma, j’ai eu l’idée de ce sujet en m’interrogeant sur la filmographie de certains réalisateurs. Je me désolais de voir certains réalisateurs tourner un peu trop en rond. Et je me demandais pourquoi certains n’osaient pas bousculer leurs propres codes et si le faire était aussi risqué que ce que l’on pourrait croire. Ensuite, ma fascination pour le concept de marque humaine a fait le reste…
Avec qui avez-vous travaillé sur vos recherches ?
Mon directeur de thèse, le professeur Bernard Pras, a énormément travaillé avec moi sur cette recherche. Nous avons tous les deux été captivés par ce sujet passionnant et surtout par les résultats statistiques que nous avons obtenus !
Quelle grande figure (de la science / lettres / sciences humaines) vous a inspirée ?
Les travaux des sociologues Max Weber et Pierre Bourdieu m’ont beaucoup guidée dans ma réflexion sur la construction de la légitimité de la marque d’un individu. Sinon, dans mon propre champ, celui du marketing, j’ai été inspirée par les travaux de Marie-Agnès Parmentier qui a travaillé sur les marques des mannequins, et ceux de Delphine Dion et Eric Arnould qui ont travaillé sur les marques des grands chefs cuisiniers ainsi que les directeurs artistiques dans le luxe. Sans oublier, les travaux de Nathalie Fleck sur l’incongruence !
Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (l’impact socio / économique / scientifique) visible et tangible pour le grand public ?
Les implications managériales de ma thèse sont importantes pour les réalisateurs de films. Dans le dernier chapitre de ma thèse, je dresse des recommandations marketing stratégiques qui découlent directement de mes résultats pour chaque type de réalisateur (c’est-à-dire le réalisateur plutôt commercial, le réalisateur auteur inscrit dans un genre précis, et le réalisateur auteur éclectique). Pour le grand public, ma thèse apporte un nouvel éclairage sur les mécanismes opérant au sein du secteur cinématographique. Dans ce secteur, l’accent médiatique est généralement mis sur les acteurs. Je propose de regarder de l’autre côté de la caméra, les réalisateurs, et de comprendre quels sont les enjeux autour de leurs films, de leurs choix créatifs et surtout les répercussions de ces choix sur leur identité de marque, leur légitimité et plus généralement sur leur carrière.
MT180 2016 - Benjamin Scholtes (MINES ParisTech)
Développement d’un formalisme level set performant pour la modélisation en champ complet de la recristallisation dans un contexte industriel
Sous la direction de Marc BERNACKI (Mines ParisTech)
 Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?
Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?
En quatrième année de mon cursus ingénieur, j’ai réalisé un stage ingénieur de six mois chez Danone Research à Evian-les-Bains. J’étais chargé de modéliser sur ordinateur le comportement mécanique des pots de yaourt pendant leur transport. Cette expérience m’a emballé ! Je me suis découvert une vraie passion pour la programmation et le calcul sur ordinateur. Réaliser une thèse, c’était donc pour moi une occasion rêvée d’acquérir des connaissances plus poussées dans ce domaine qui me passionne. J’espère pouvoir les mettre à profit dans ma future carrière.
Avec qui avez-vous travaillé sur vos recherches ?
Il s’agit d’une thèse CIFRE financée par l’éditeur de logiciels Transvalor, qui a des liens très fort avec mon laboratoire (CEMEF, Sophia Antipolis). Je travaille donc avec leurs ingénieurs, qui sont chargés du développement des logiciels. Ma thèse s’inscrit également dans un projet de recherche plus large, financé par un consortium d’industriels d’envergure internationale (Safran, ArcelorMittal, Aubert & Duval, CEA, Areva, ASCOMETAL, Timet).
Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (scientifique) visible et tangible pour le grand public ?
Les développements que j’ai réalisés au cours de mes travaux sont directement intégrés dans un logiciel commercial, DigiMu®, dédié à la modélisation des évolutions microstructurales. En d’autres termes, il permet de reproduire sur ordinateur les phénomènes microscopiques ayant lieu lors de la mise en forme des métaux. Depuis quelques années, il y a un besoin de plus en plus fort pour ces méthodes numériques dans les industries de pointe (aéronautique, nucléaire, élaboration d’alliages hautes performances…). Dans ma thèse, je suis chargé de réduire les temps de calculs liés à l’utilisation de ce logiciel afin de permettre son utilisation dans un contexte industriel. Le fait de savoir que les résultats de mes recherches sont intégrés dans un logiciel commercial avant même la fin de ma thèse est extrêmement motivant pour moi.
Qu’est-ce que PSL vous a apporté concrètement dans le cadre de vos études ? (collaborations, diffusions, informations, etc).
PSL me donne l’occasion de participer à cette belle aventure qu’est » Ma thèse en 180s « . Arrivant bientôt à la fin de ma thèse, c’est une expérience unique qui me permet de valoriser mes recherches et de les partager avec le grand public. Qui plus est, c’est pour moi un super challenge de représenter mon laboratoire (le Centre de Mise en Forme des Matériaux) dans ce concours à fort rayonnement.
MT180 2016 - Thomas Ferrand (Ecole normale supérieure)
Reproduction expérimentale d’analogues de séismes mantelliques et comparaison avec des pseudotachylites naturelles
Sous la direction de Alexandre Schubnel (ENS-CNRS) et Nadège Hilairet (UMET Lille-CNRS)
 Comment l’idée vous est-elle venue ?
Comment l’idée vous est-elle venue ?
Je m’interrogeais sur le manteau et la serpentine depuis plusieurs années, et ce projet proposé au Laboratoire de Géologie de l’ENS tombait à pic.
Avec qui avez-vous travaillé sur vos recherches ?
Je travaille avec des chercheurs de plusieurs laboratoires en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. Il existe une excellente coopération entre géophysiciens, physiciens des matériaux, cristallographes, minéralogistes et tectoniciens.
Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (l’impact socio / économique / scientifique) visible et tangible pour le grand public ?
Il s’agit de recherche fondamentale sur la mécanique des séismes. L’impact des résultats est indéniable pour les géologues, les géophysiciens, les physiciens des matériaux, etc… mais pas directement pour le grand public. Néanmoins, sans recherche fondamentale aujourd’hui, il ne pourra pas y avoir de recherche appliquée demain. Et l’application de ce travail sera peut-être un jour (lointain) la contribution à la prédiction des séismes.
 UNIVERSITÉ PSL
UNIVERSITÉ PSL
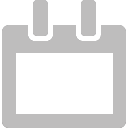



 Alice de Rochechouart
Alice de Rochechouart